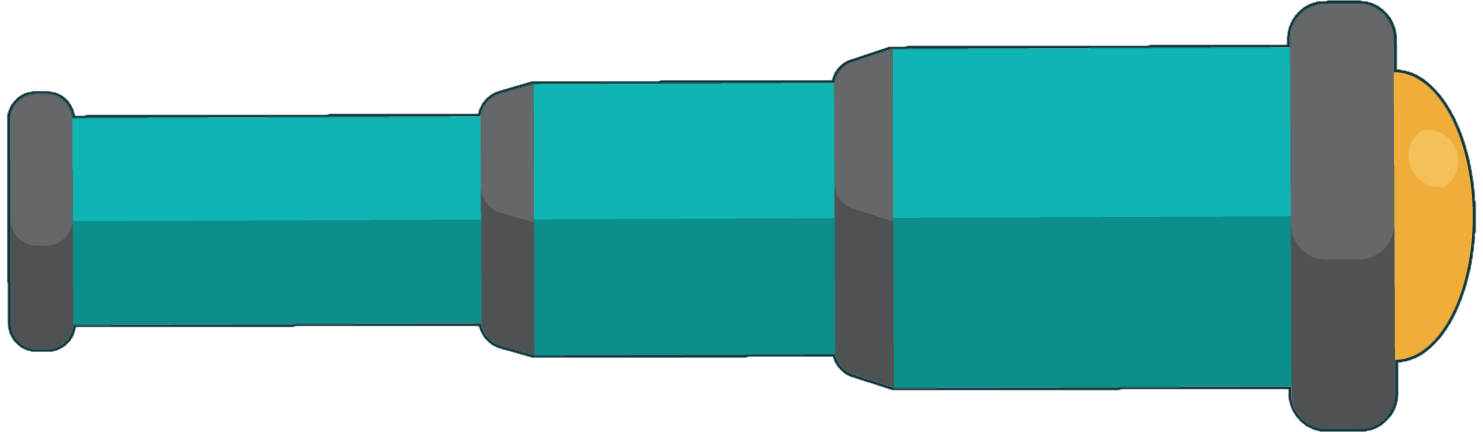Parallèlement à l’importance qu’elle donne au DDRS – Développement Durable et Responsabilité Sociétale –, l’Université de Strasbourg accorde une place de choix à la TEDS. En la personne de Julien Delord, la Transition Écologique pour un Développement Soutenable investit ainsi une formation destinée aux étudiants de l’INSPÉ. De quoi outiller les futurs enseignants de demain à ce thème, qui se conjugue aussi bien au présent qu’au futur.
Sommaire de la page
2024

Julien Delord est Maître de conférences dans l'enseignement de la Transition Ecologique et du Développement Soutenable (TEDS) à l'université de Strasbourg et à l’Institut Supérieur du Professorat et de l’Education (INSPE) depuis janvier 2024.
Cet enseignement, sous forme de modules, est dispensé auprès des étudiants en Licence 3 Eduquer et Enseigner à l’Ecole (E3), prochainement Sciences de l’Education et de la Formation parcours Professorat des Ecoles et en Master 2 Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation 1er degré (MEEF) et 2nd degré.
1. La Transition Écologique pour un Développement Soutenable
Avant d’entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous définir et expliquer ce qu’est la TEDS et pour quelle raison il s’agit d’une question dont l’enseignement supérieur doit se saisir ?
La TEDS est le nouvel acronyme désignant « Transition Écologique pour un Développement Soutenable », qui est apparu au moment du rapport Jouzel-Abbadie rendu en 2022. Il fut commandé, par la ministre de l'Enseignement Supérieur alors en place, dans le but de généraliser, à tous les niveaux, une formation aux enjeux contemporains de la transition écologique. Cela englobe l'anthropocène, c’est-à-dire la situation actuelle qui fait de l’activité humaine une force géologique majeure, puis les transitions écologiques, énergétiques, numériques ou encore sociales. Celles-ci devront être mises en place d'ici 2050 pour que la société française soit plus respectueuse des limites planétaires et neutre en carbone. Ce rapport a, de manière inédite, proposé qu'il y ait un enseignement obligatoire en licence aux enjeux de la transition écologique. Les modules actuels de sensibilisation autour de la responsabilité sociétale, de la lutte contre les discriminations sexuelles ou de genre, etc. demeurent néanmoins toujours facultatifs. Pour notre cas, les modules que nous avons développés sont obligatoires. Cela montre l'importance attribuée à la question de la transition écologique, d’autant plus qu'il faut insérer ce dernier dans des parcours qui, a priori, peuvent être très éloignés des enjeux écologiques actuels.
2. Cadre de la formation
Dans quel cadre allez-vous former les enseignants de demain à la TEDS ?
Ce dispositif sera appliqué à l'INSPE de l'Académie de Strasbourg dès septembre 2024. Il est réalisé en collaboration avec deux Directeurs adjoints, à savoir Philippe Zimmermann, chargé des pratiques pédagogiques et de la démarche qualité, et Eric Tisserand, chargé de l'organisation et du pilotage des études. Il comprend une formation à la TEDS sous forme de modules. Les premiers seront mis en place dans les licences 3 des sciences de l'éducation, et se concentreront sur la transmission de connaissances à propos de l'anthropocène et des transitions écologiques. Les étudiants de master auront, eux, de nouveaux modules à visée beaucoup plus participative et professionnalisante avec des mises en situation et des préparations de séquences de cours. L’objectif est que les étudiants et futurs enseignants du primaire et du secondaire aient les clés pour proposer des activités autour de la transition écologique et du développement soutenable.
Dans l'enseignement primaire et secondaire, il y a déjà des modules et des sensibilisations sous l’appellation « développement durable ». Rajouter la dimension des transitions écologiques nous met face à des enjeux de transformation réels, matériels, économiques et politiques plus importants avec un rythme que ne posait pas le développement durable. La transition, elle, implique des délais à respecter, à l’horizon 2050, qui font passer de la sensibilisation à la transformation des comportements et des relations autour de l’écologie.
3. Pédagogie
Quel sont vos enjeux pédagogiques ?
Les enjeux pédagogiques sont de former aux compétences mentionnées par les rapports Jouzel et le référentiel européen GreenComp (lien en anglais) relatives à la transition écologique. Il s’agit de comprendre ce qu'est un écosystème, ou système au sens large, ainsi que les interrelations complexes en son sein ou encore de situer les véritables enjeux sur des échelles de temps, d'espace mais aussi d'énergie. Pour ce faire, les étudiants devront développer des séquences pédagogiques. L'idée serait de les développer avec des partenaires locaux, des associations de défense de l'environnement, de maîtrise de l’énergie ou des institutions, tels que le Muséum d'histoire naturelle par exemple. L’intention est de sortir du cadre purement scolaire ou universitaire et de lier les enjeux sociaux à ceux de leur formation.
Cette formation obligatoire vise à sensibiliser de manière poussée tous les étudiants, quel que soit leur domaine et discipline de formation, aux enjeux de la transition écologique. La formation est établie sur un apport de connaissances liées aux dynamiques actuelles et aux acteurs principaux de modification du climat comme la biodiversité, les ressources et l'énergie. Néanmoins, il y a derrière cela la nécessité de se saisir de ces enseignements pour développer des compétences qui doivent être renforcées, telles que la pensée critique. Quelles que soient les modélisations qui ont été faites, le climat ne va pas arrêter de se modifier, voire d’empirer dans les décennies qui viennent. Il en est de même pour la biodiversité. Jusqu'en 2050, il va falloir s'adapter en permanence à de nouvelles conditions de vie et de fonctionnement social. Le but est alors de pouvoir se référer à une sorte de méta-compétence qui inclut l'adaptabilité permanente individuelle, mais surtout collective, fondée sur cette pensée critique qui permet d’évaluer, de critiquer ou de juger la multiplicité des chemins de transition socio-écologiques qui s’ouvrent devant nous.
Il y a également la littératie des futurs qui traite des valeurs de soutenabilité et d’actions responsables dans un cadre qui soit le plus égalitaire et équitable possible pour les générations futures. Elle permet de se projeter dans l‘avenir et de concevoir de nouveaux imaginaires. Cela se distingue de nos mythes actuels de la croissance infinie et du technosolutionnisme, où le progrès technique résoudrait tous les problèmes. Enfin, il y a les engagements politiques, au sens large, mais aussi associatifs, personnels et collectifs. Ces engagements permettront de définir de nouveaux systèmes économiques, politiques et sociaux qui mèneront à une transition écologique.
4. Défis et écueils
À ce stade – celui de la conception de cette future formation – quelles difficultés identifiez-vous ?
Ces modules sont assez complets et seront employés à l’INSPE en licence 3 et en Master 2. Pour ne pas que cela soit perçu comme du rabâchage, il faut un apport clairement identifié chaque année. Cependant, l’agencement des maquettes de master ne permet pas d’accorder un nombre d'heures plus important, ce qui aurait pu favoriser un travail en profondeur sur un projet pédagogique.
Une autre difficulté est liée au fait que tous les enseignants de l'INSPE ne sont pas spécialistes des questions de la transition écologique. Certains doivent ainsi se saisir de domaines qu'ils maîtrisent moins, afin de pouvoir ensuite proposer des cours. Cela représente un pari organisationnel et de mise en commun de nos ressources et de nos approches. Vient ensuite la question de la théorie face à la pratique. Nous avons la chance d'avoir Raphaël Sager, formateur et enseignant en collège à mi-temps, qui pourra apporter aux étudiants une mise en œuvre concrète de séquences de cours dans le secondaire. En travaillant avec des partenaires sur des séquences pédagogiques, les futurs enseignants devront faire preuve de pédagogie et de persuasion face à des parties prenantes qui sont moins engagées, comme au niveau administratif par exemple. Cela nécessitera des compétences en communication, en négociation et en mise en relation de certains acteurs. Les résultats seront d'autant plus intéressants et importants, en termes de motivation pour les élèves, qu’ils auront l'impression de véritablement travailler sur des enjeux réels et concrets, et non pas simplement sur un exemple scolaire déconnecté de la réalité.
Beaucoup d'étudiants en Sciences de l'Education viennent des Sciences Humaines et Sociales (SHS) et estiment ne pas avoir le bagage scientifique suffisant pour saisir toutes les subtilités des rapports scientifiques. Cela relève d'un manque de confiance et, peut-être, de mauvais rapports aux sciences cultivés par ces étudiants. Or, avec le Moodle Air que nous mettons en place avec l’IDIP, l’idée est d’impliquer tous les étudiants en rendant le vocabulaire et les aspects scientifiques non-rédhibitoires pour l’enseignement de la TEDS. Les principaux enjeux des transitions à venir ne sont pas uniquement scientifiques ou techniques mais nécessitent surtout des modifications de nos politiques publiques, locales et globales, de nos imaginaires, de nos représentations, de nos rapports à la nature et au futur, etc. Tout cela ne relève pas des sciences de la nature, mais bel et bien des sciences humaines.
5. Un enjeu d'envergure
Le fait que les questions de développement durable et de responsabilité sociétale soient désormais sous le feu des projecteurs : est-ce un avantage ou un inconvénient, de votre point de vue de formateur ?
C'est évidemment positif. Le sujet de la transition écologique est progressivement plus présent dans le débat public. Il faut tout de même être vigilant à ce que tout cela ne devienne pas simplement un objet anodin auquel on s'habitue sans en saisir les enjeux absolument révolutionnaires. L'enseignement de cette transition écologique ne doit donc pas être une forme de morale abstraite mais continuer à montrer l'aspect absolument inédit et inouï qui attend notre société. La généralisation des messages sur les transitions écologiques portés par les responsables politiques est une bonne chose. Cependant, des mouvements de contestation réactionnaires peuvent apparaître et remettre en cause de nombreux éléments. Nous avons pu le voir dernièrement avec certains agriculteurs, industriels et mouvements politiques, qui ont remis en cause, de manière frontale et directe, les enjeux de la transition écologique et énergétique. Certains estiment que ces sujets sont, soit exagérés, soit ne répondent pas aux urgences actuelles, soit remettent trop de choses en cause pour pouvoir être soutenues dans les années qui viennent. Le défi est donc de tenir compte de cette polarisation idéologique et de potentiellement la dépasser en explicitant les enjeux philosophiques, politiques et économiques à venir. La transition écologique est profondément multidisciplinaire. Nous ne pouvons qu'inciter les enseignants à faire preuve d'initiative et à collaborer autour de projets interdisciplinaires où les visions transcendent les disciplines. Il faut que cette notion d'interdisciplinarité soit centrale dans l'enseignement de la TEDS. Cela représente un challenge et une opportunité pour que les collègues puissent collaborer autour de nouveaux projets avec des personnes avec lesquelles elles n'avaient peut-être pas eu l’opportunité d’échanger.
De nombreuses enquêtes ont montré que dans la jeunesse actuelle, beaucoup se déclaraient éco-anxieux. Cela peut être l’expression d’une colère ou d’une inquiétude, mais, surtout, d’une certaine appréhension du futur. Un des acquis de ces enseignements de la TEDS montre que, face à l'évolution prévisible du climat et les mégacatastrophes annoncées pour les années à venir, un enseignement uniquement théorique peut même renforcer cette anxiété. En revanche, évoquer les actions, les solutions ou les formes d’agentivité et de puissance d’agir pour transformer la société, aux niveaux individuels et collectifs, permet de rassurer. En tant qu’enseignants, nous devons être à l'écoute et démontrer, par notre enseignement, qu’avoir le sentiment de pouvoir agir et transformer les choses est un des meilleurs vecteurs de dépassement de ces peurs.
6. Collaborations
Dans le cadre de cette formation, allez-vous dresser des ponts avec les autres structures impliquées dans la TEDS ?
Pour l'enseignement hybride, nous nous inspirons des cours en ligne ouverts à tous (MOOC1) de l’Université Virtuelle Environnement et Développement Durable (UVED). Ils ont été adaptés dans le Moodle Air grâce aux synthèses, produites par Roselin Martinez Jimenez de l’IDIP, qui permettent aux étudiants de mieux saisir les points essentiels de chaque partie. Nous enrichissons ces cours avec, par exemple, des cas concrets de controverse autour des transitions, comme les taxes carbone avec leurs dimensions aussi bien psychologiques, politiques, économiques, que techniques. Il faut donc montrer que la complexité des transformations, les décisions politiques et les controverses qu’impliquent les transitions, sont des étapes nécessaires à l’avancée des transitions écologiques.
Egalement, il y aura localement des ponts qui seront établis avec des structures existantes. Le but est de valoriser l'engagement étudiant autour des enjeux écologiques et de développement soutenable. Les associations étudiantes de l’INSPE pourraient ainsi, potentiellement, inciter et accompagner des actions de verdissement.
1Massive Open Online Courses
7. Portée de la formation
Vous allez mettre en place cette formation pour la première fois à la rentrée prochaine, envisagez-vous d’ores et déjà d’en faire ensuite le bilan et comment ?
Nous ferons un bilan à la fois quantitatif et qualitatif. Nous recueillerons les ressentis personnels des étudiants afin de comprendre si notre enseignement les aura fait avancer en compétences. L’intention sera d’observer s’il y a eu un effet transformateur sur eux, concernant l'éco-anxiété, leurs questionnements, mais aussi par rapport aux actions qu’ils seraient personnellement prêts à mettre en œuvre.
8. Partage
En quoi le partage des pratiques pédagogiques est-il enrichissant dans le cadre de votre enseignement, ainsi que pour vous-même ?
Je vois émerger de nouvelles approches dans des disciplines qui m’étaient peu connues. Par exemple, en design, l'enseignement de la TEDS a pu faire émerger des réflexions très poussées dans la conception d'objets. Parfois, les pratiques pédagogiques peuvent être presque déstabilisantes, comme ce que l'on appelle la « Fresque des nouveaux récits ». Cela implique de faire travailler beaucoup plus son imagination que la cognition classique. Il existe également des pratiques pédagogiques établies sur l'auto-évaluation écologique.
La transition écologique va induire des bouleversements, aussi bien sociaux que personnels tout à fait inédits. Avec ces enjeux-là, nous avons besoin de confronter et de généraliser de nouvelles pratiques pédagogiques, en les rendant peut-être hybrides, mais surtout, en faisant preuve d'inventivité. Il faut aussi imaginer de nouvelles compétences. Venant du milieu de la didactique des sciences de la vie, mes réflexions étaient, jusque-là, à propos d'épistémologie, d'acquisition des connaissances et de méthodes scientifiques. J'ai pu prendre conscience de certains aspects, et être plus à l'écoute, grâce à la TEDS. Par exemple, l'utilisation des émotions dans la mise en place de projets est un élément que j’avais, jusque-là, complètement négligé. J'espère maintenant que tous les enseignants pourront, eux-mêmes, enrichir leurs propres compétences pédagogiques. J'estimerais avoir gagné mon pari de pédagogue lorsque j’aurais convaincu mes collègues que l'enseignement de la TEDS et de l'anthropocène doit les amener à des changements de pratiques et de valeurs, à ouvrir leur horizon pédagogique et à mettre en œuvre des contenus résolument engagés en faveur de la transition écologique.
Propos recueillis par Coline Fuchs